|
|
Ait Larbi Arezki
Date de création: 10-06-2018 15:26
Dernière mise à jour: 10-06-2018 15:26
Lu: 1562 fois
VIE POLITIQUE – PERSONNALITES- AIT LARBI AREZKI
© Hamid Tahri/ El Watan, Portrait. Jeudi 21 avril 2016. Extraits
«En arrivant à l’université d’Alger en 1974, je découvre le théâtre de Kateb Yacine avec La guerre de 2000 ans, puis les cours de berbère de Mouloud Mammeri au CRAPE (Musée du Bardo). Dans le monde, les années 70’ restent marquées par des événements majeurs dans lesquels les étudiants étaient à l’avant-garde. Comme Mai 68 en France, ou la mobilisation contre la guerre du Vietnam aux USA.
Pendant un temps, j’étais fasciné par Baader-Meinhof en Allemagne et les Brigades rouges en Italie ; ma sympathie ira finalement vers les dissidents de l’URSS qui résistaient pacifiquement face à une dictature qui était le modèle du régime algérien. En 1979, je me rapproche du FFS clandestin, relancé quelques mois auparavant par un groupe de militants qui m’avaient précédé à l’université. Après une rencontre avec Saïd Sadi qui coordonnait le mouvement en Algérie, je décide de rejoindre le FFS clandestin.»
Comme on le constate, Arezki a pris goût très jeune pour l’engagement politique même si les idées qu’il défendait allaient souvent se fracasser contre les réalités et la brutalité d’un pouvoir autiste, mais habile manipulateur. Sans doute Arezki a-t-il retenu de cette période une forme d’attachement aux problèmes qui font mal à la société. Le Printemps berbère de 1980 allait se poursuivre avec son lot d’emprisonnements, de grèves et de sacrifices. Les libertés s’arrachent par les plus déterminés et Kipling n’avait-il pas écrit un jour «Tout bien considéré, il y a deux sortes d’hommes dans le monde : ceux qui restent chez eux et les autres…»
«En riposte à l’interdiction, le 10 mars 1980, de la conférence de Mouloud Mammeri sur les ‘‘Poèmes kabyles anciens’’, la communauté universitaire de Tizi Ouzou descend dans la rue pour crier sa colère. Les lycéens, puis les ouvriers des grandes entreprises publiques leur emboitent le pas. Après la grève générale du 16 avril 1980, c’est toute la Kabylie qui entre en dissidence. Après la manifestation réprimée dans la capitale le 7 avril 1980, l’université d’Alger entre à son tour dans la contestation. Dans le Comité de coordination qui dirige le mouvement à Alger, je représente la faculté de Médecine. Le 20 avril, le pouvoir ordonne d’évacuer par la force le Centre universitaire de Tizi Ouzou, l’hôpital et les entreprises publiques occupées par les grévistes.
Bilan : des centaines de blessés, des dizaines d’arrestations. Je fais partie des 24 détenus qui sont déférés devant la Cour de sûreté de l’Etat pour ‘‘complot subversif visant à renverser le régime’’. Grâce à la mobilisation de la population en Kabylie et des étudiants d’Alger, nous serons libérés le 26 juin 1980.....
Quelles étaient les conditions de lutte et d’incarcération de ces jeunes résolus ? «En mars 1981, nous avons créé le Collectif culturel de l’université d’Alger qui animait la vie politique et culturelle dans les campus : meetings, conférences, débats contradictoires... Le professeur Salem Chaker animait tous les lundis un cours ‘‘sauvage’’ de berbère à l’amphi B Lettres de la Fac centrale. Le 19 mai, la police intervient une nouvelle fois pour ‘‘mettre un terme à l’agitation’’. Je fais partie des 22 étudiants d’Alger arrêtés et détenus à la prison d’El Harrach pendant 8 mois. Fin 1983, le FLN tente d’initier en Kabylie un mouvement de fils de chouhada pour l’opposer aux étudiants contestataires.
Avec quelques militants du Mouvement culturel berbère (Nordine Aït Hamouda, Mokrane Aït Larbi, Nacer Babouche, Rabah Benchikhoun, Amar Falli et Ferhat Mhenni notamment), nous lançons un mouvement concurrent sous le mot d’ordre : ‘‘Non à la manipulation de la mémoire des martyrs à des fins de légitimation de pouvoir’’, et un positionnement politique sans équivoque : ‘‘Respect des droits de l’homme, démocratie, pluralisme politique et culturel’’. Le mouvement réussit à s’étendre à Alger, Boumerdès, Chlef et Tipasa. Le 5 juillet 1985, nous décidons de déposer des gerbes de fleurs en marge des cérémonies officielles.
De prison en prison
La police nous arrête au pied des monuments aux morts ! Nous serons déférés une nouvelle fois devant la Cour de sûreté de l’Etat pour ‘‘atteinte à l’autorité de l’Etat et distribution de tracts subversifs’’. C’est mon troisième séjour en prison. La Ligue algérienne des droits de l’homme, dont la création a été annoncée quelques jours auparavant, dénonce ces arrestations. Son président, Abdennour Ali-Yahia, puis son vice-président, Mokrane Aït-Larbi, ainsi que des membres du Comité directeur Saïd Doumane, Ferhat Mhenni, Hachemi Naït Djoudi et Saïd Sadi sont arrêtés les uns après les autres.
Jugés par la Cour de sûreté de l’Etat du 15 au 19 décembre 1985, le verdict tombe : de 6 mois à 3 ans de prison ferme. Je fais partie du groupe condamné à 3 ans de prison ferme. Avec Arezki Abboute, Saïd Doumane, Ferhat Mhenni, Ali-Fewzi Rebaïne et Saïd Sadi, je me retrouve, début janvier 1986, au sinistre pénitencier de Lambèse, près de Batna, réputé pour ses conditions de détention infrahumaines.
Dès notre arrivée, nous sommes accueillis à coups de barres de fer, puis les gardiens nous ont retiré nos vêtements, avant de nous jeter, tout nus, dans des cachots humides en plein hiver. Nous y resterons plusieurs jours. Avec moi à Lambèse, et mon frère Mokrane, détenu à Blida, puis déporté à Bordj Omar Driss, dans le Grand Sud, cet épisode a été très pénible pour notre famille. Nous serons libérés le 24 avril 1987 suite à une ‘‘grâce’’ amnistiante»........
Membre fondateur du RCD en février 1989, j’étais chargé des relations avec la presse jusqu’à ma démission de ce parti en octobre 1991. ........J’avais mesuré toute la différence entre la passion d’un engagement militant pour une grande cause et le réalisme, souvent cynique, de ceux qui font de la politique.
Nous sommes dans un pays où toutes les carrières sont possibles pour celui qui sait ‘‘s’adapter’’ aux codes du sérail. Mais la ‘‘fonction’’ de citoyen est sans doute la plus périlleuse. En quittant l’activité partisane, je n’ai pas renoncé pour autant à mon engagement pour les libertés et les droits de l’homme.» Aujourd’hui Arezki continue d’œuvrer à l’obsession de sa vie : la politique, mais autrement après les longs et riches enseignements tirés de sa douloureuse expérience. Quel regard porte-t-il sur la confiscation des libertés ?
«Nous vivons dans une société liberticide. L’individu n’aime pas ses semblables quand ils sont trop différents. Au nom de prétendues ‘‘valeurs civilisationnelles’’, on traque les ‘‘déjeuneurs du Ramadhan’’ ; on arrête une jeune femme parce qu’elle avait une bible dans son sac ; on stigmatise, dans certains quartiers, l’indécence vestimentaire de jeunes filles occidentalisées parce qu’elles ne portent pas le voile.
Ces manifestations, parfois violentes, de l’intolérance sont encouragées par le pouvoir qui a fini par adopter ces ‘‘normes’’, au mépris des lois de la République. Actuellement, c’est la fuite dans la répression. Les enseignants grévistes de la faim ont été violemment délogés par la police ce lundi à 3 heures du matin. Pourtant, leur mouvement était pacifique et la dignité de leurs moyens de lutte force le respect.»
Arezki évoque la liberté de la presse et surtout son expérience en tant que correspondant de journaux d’ici et d’ailleurs.
«J’ai eu la chance de travailler librement dans de grands journaux : L’Hebdo Libéré, Le Jeudi d’Algérie, L’Opinion, et enfin Ruptures. Après l’assassinat de Tahar Djaout, son directeur de la rédaction Ruptures ne lui a pas survécu. Avec les restrictions imposées par l’état d’urgence, j’ai décidé de prendre du recul, avant de revenir, en 1994, comme correspondant de plusieurs journaux étrangers, notamment La Libre Belgique, Ouest-France, Le Figaro, Le Point.
En demandant mon accréditation au ministère des Affaires étrangères, le fonctionnaire chargé du dossier m’a fait une proposition surprenante : il voulait me remettre le numéro de téléphone du colonel du DRS chargé de la presse pour ‘‘prendre rendez-vous et discuter autour d’un café’’. En refusant de me soumettre à cette curieuse procédure, mon accréditation a été bloquée. J’ai toutefois continué mon travail sans subir de pressions particulières. Unique mesure de rétorsion : le dossier, déposé en 2005, pour la création d’un journal hebdomadaire a été également bloqué.
J’ai eu à dénoncer ces pratiques illégales, notamment dans El Watan, lorsque ce colonel était encore en fonction. Maintenant que le DRS est dissous, je ne veux pas rejoindre la horde de ceux qui ciraient les bottes de ces officiers et qui tentent aujourd’hui de leur mordre les mollets en jouant les victimes. En fin de compte, un abus de pouvoir n’est, le plus souvent, que l’expression d’un abus d’obéissance. Reconnaissance de Tamazight : acquis ou leurre ? La question brûlante n’est pas éludée.
«On est passé de l’exclusion-répression à la récupération-étouffoir. Dans les années 70’, on arrêtait des lycéens pour la possession d’un alphabet Tifinagh. Dans les années 80’, les militants étaient pourchassés comme ‘‘ennemis de l’intérieur, relais de l’impérialisme’’. Depuis quelques années, les laboratoires occultes ont trouvé la parade par un nouveau slogan : ‘‘Nous sommes tous des Amazighs.
Tamazight n’est pas le monopole d’une région’’, sous entendu : la Kabylie, berceau de la revendication depuis la crise anti-berbère de 1949. Derrière l’évolution du discours, l’objectif reste identique : Tamazight doit être assigné à résidence dans le passé, le folklore et le musée. Pour toutes les institutions de l’Etat, l’école, la justice..., l’arabe reste la langue officielle unique.
Le triptyque identitaire officiel — arabite-islamité-amazighité — en vogue depuis les années 90’ est une imposture. La culture arabe a eu deux capitales : Alger en 2005 et Constantine en 2016 ; la culture islamique a eu sa capitale à Tlemcen en 2011. Pour la culture amazighe : rien. A cette identité artificielle imposée par décret, il est temps de substituer les identités vécues, ressenties, nécessairement plurielles. Il serait illusoire d’imposer une langue sur le mode autoritaire à ceux qui la refusent.
Ceci est valable pour Tamazight, mais aussi pour l’arabe dans ses différentes variantes : classique et dialectale. Il est temps de réfléchir à une nouvelle forme d’organisation de l’Etat et des territoires qui passe par l’autonomie des régions. En Kabylie, l’idée commence à faire son chemin. Sortie de la diabolisation, mais aussi de la surenchère et du slogan, l’autonomie régionale permettra à chacun de vivre sereinement son identité et de s’épanouir dans sa culture et sa langue, dans le respect de celles des autres.»
Editer des ouvrages «osés» et iconoclastes à travers sa maison d’édition Koukou, n’est-ce pas là un exercice à haut risque ? «Koukou Editions est l’une des rares maisons d’édition exclues des subventions de l’Etat. C’est le prix de l’indépendance. Elle résiste toutefois grâce à la confiance d’auteurs de qualité, de plus en plus nombreux, et à la fidélité de leurs lecteurs. Au-delà des problèmes matériels qui limitent les ambitions dans leur volet quantitatif, la sortie d’un livre est toujours un moment de bonheur. L’affluence des lecteurs aux ventes-dédicaces et pendant le Sila est un encouragement qui conforte la ligne éditoriale de Koukou Editions.»
Comment Arezki voit-il l’avenir de l’Algérie ?
«L’Algérie est sur un volcan. Au sommet de l’Etat, l’on semble assumer avec une arrogance bien rare la corruption qui a gangrené de larges factions du pouvoir. Avec une justice soumise qui s’autosaisit pour défendre des intérêts claniques, mais qui détourne le regard devant le scandale planétaire qui a éclaboussé des barons du régime, la grogne populaire couve. Et, à moins d’un miracle, la marmite finira par exploser. Face à un pouvoir autiste, le sursaut ne viendra pas des partis politiques qui, majoritairement, sont des démembrements du système qu’ils feignent de combattre dans ses manifestations les plus inacceptables.» Enraciné dans sa vie de famille, distingué, intuitif, Arezki a de fortes convictions sociales et humanistes. Mais depuis qu’il s’est émancipé, il est un homme de séduction et de réflexion plus que de tempêtes.
Parcours
Naissance le 11 août 1955 au village Aït Si Amara près du sanctuaire de Cheikh Mohand Oulhoucine – Aïn El Hamam. Son père est mort pendant la guerre de Libération nationale alors qu’il avait 3 ans.
Scolarisé en 1963 à l’âge de 8 ans grâce à d’anciens maquisards, dont Si L’Hafidh Yaha décédé en février dernier, qui ont créé les premiers centres d’enfants de chouhada où il se retrouve avec d’autres orphelins de la guerre.
1967, admis en 6e au collège d’Azazga.
1971, lycée Chihani Bachir de la même ville. Animateur du journal du lycée.
1974, bac mathématiques, première promotion de l’université de Bab Ezzouar pour un DES en physique, avant d’entamer des études en médecine. Après plusieurs interruptions en raison des multiples séjours en prison qu’il a eu à subir dans les années 1980, il a fini par renoncer à la médecine alors qu’il était à une année de la fin. Marié, père de deux enfants.
© Hamid Tahri |
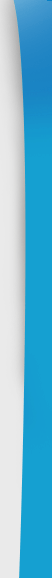 |