|
|
Information - Libertés
Date de création: 19-06-2018 12:52
Dernière mise à jour: 19-06-2018 12:52
Lu: 2151 fois
COMMUNICATION – ETUDES ET ANALYSES – INFORMATION- LIBERTES
AMMAR BELHIMER
La malédiction autoritaire
© Par Ammar Belhimer, Professeur de droit public, Université d’Alger 1/ El Watan Week-end, Vendredi 23 octobre 2015
Sur la liberté d’informer dans le pays depuis le 4e mandat
L’honnêteté intellectuelle commande de dire que les restrictions chroniques aux libertés ne datent pas du 4e mandat en cours. Elles sont consubstantielles à la nature policière
du régime qui transcende les particularités du moment. C’est une question de degré et non de nature. Le système reposera sur la violence tant que ne sera pas soulevée, et pacifiquement traitée, la question de la reconstruction d’une historicité longtemps et toujours pervertie par un mode de gouvernance qui fait de cette violence le seul langage et la seule ressource des hommes aux commandes depuis 1962. Multiforme, ambivalente et paradoxale, la violence est inscrite dans le mode d’exercice du pouvoir et n’autorise de respect et de considération que pour le guerrier, le porteur d’armes, au mépris de l’intellectuel qui manie la plume. Omar Carlier traduit mieux que nous cette obsession filiale, congénitale de la violence dans son ouvrage de référence «Entre nation et djihad - Histoire sociale des radicalismes algériens», paru aux Presses de Sciences Po, à Paris en 1995 : «Un homme valide s’impose et se positionne socialement non par le respect dont il s’entoure, mais par la crainte qu’il inspire. Le conte, le mythe, le proverbe, la chanson véhiculent une norme de conduite qui valorise le recours à la force et à la ruse. Ils définissent les éléments d’une éducation populaire qui contribue à enraciner dans les représentations collectives la pertinence pernicieuse et l’efficacité supposée de la violence.» Telle est l’origine du mal endémique que j’appelle «la malédiction autoritaire.»
La violence est-elle à ce point prenante ?
Nous sommes ici dans une situation où les présumées victimes n’ont rien à envier à leurs bourreaux. C’est en effet une violence systémique, inscrite dans les institutions et diffusée dans tout le corps social. Telle est la matrice du système. En matière institutionnelle, l’arbitraire éclipse tout système méritocratique qui ambitionnerait de mettre en relation des hommes libres et égaux, reliés par des conventions négociées, hiérarchisés et mis en conditions de compétitivité par leur seul mérite. Cette matrice se décline par des mécanismes de régulation d’essence policière, et non militaire. Elle mobilise des hommes configurés dans le même logiciel hérité de l’ennemi depuis la guerre de libération nationale, ennemi qui a lui aussi toujours
fait la part belle aux services spéciaux.
Ici, comme dans d’autres domaines, le mimétisme a également opéré. Les Français ont substitué aux «bureaux arabes» de la conquête une noria de services en 1954 (les «maîtres Jacques de la colonisation» qu’étaient les «bureaux arabes», puis l’officier de renseignement proprement dit relevant du deuxième bureau, l’officier du service «action», l’officier d’action psychologique relevant du 5e bureau et enfin l’officier de SAS). Ce à quoi venaient s’ajouter la Gendarmerie nationale, les officiers du contre espionnage ou SDECE délégués en Algérie
et les organismes civils relevant de la police (Surveillance du territoire, Police judiciaire, Renseignements généraux). Par mimétisme, par paresse ou par manque d’intelligence, le camp adverse s’est aligné. L’inquisition sous le PPA et l’avènement du MALG, puis les péripéties de l’indépendance relèvent de cet apprentissage policier si bien analysé par Jacques Frémeaux dans La France et l’Algérie en guerre (Paris 2002) : «Sept ans de guerre ont privilégié, au sein des deux camps, la manipulation, la propagande et la tentation totalitaire». L’assassinat d’Abane Ramdane, la chasse aux intellectuels, la «Bleuite» sont les expressions les plus manifestes de cette lame de fond irréversible à ce jour.
Que faut-il en déduire ?
Principalement que ces canaux sont inaptes à faire émerger une classe politique et une société civile libérées des scories de la pensée unique. Ce qui est en cause ici,
ce n’est pas l’Etat lui-même, nécessaire et indispensable, dans une version inclusive et efficace, mais le mode d’exercice du pouvoir : dans les sociétés civilisées, le pouvoir est
incarné par la loi et l›autorité qui lui donne corps, il est affaire d’équilibres institutionnels, de contre-pouvoirs et de contrôles, de rapport de force et non d’épreuves de force.
Il faut tout de même nuancer le propos. Les répressions ne sont pas massives et systématiques, beaucoup d’initiatives indépendantes et critiques des autorités en place peuvent être menées au grand jour. On soulignera également l’absence de critères clairs permettant d’apprécier le risque encouru : où est la frontière à ne pas dépasser pour éviter les persécutions ? Cette frontière semble ténue du fait du relâchement de l’autorité et l’accentuation de l’impression de chaos qui autorise des muftis cathodiques à sévir contre des intellectuels, l’exercice
de monopoles de faits et autres abus de positions dominantes dans l’impunité totale.
Y a-t-il une issue à cette logique de prévalence de la violence ?
L’addiction au pétrolière a pour corollaire une malédiction autoritaire qui se traduit par un déficit démocratique structurel chronique. Des recherches récentes mettent en évidence que l’un des effets de la rente «est qu’elle produit de la violence dans le sens où ceux qui en sont les principaux détenteurs, gestionnaires et utilisateurs, ont des moyens considérables à leur disposition pour pouvoir édifier des appareils de sécurité extrêmement importants, complexes et performants qui limitent toute forme de contestation, voire de démocratisation. La rente devient un bien précieux à ne pas partager (…) Un Etat sans rente est beaucoup plus consensuel, mesuré et nuancé avec les mouvements d’opposition» (dixit Luiz Martinez, in «La rente pétrolière source de violences pour l’Algérie», in Moyen-Orient, n° 7, août-septembre 2010, pp. 32-36). Les velléités démocratiques systématiquement avortées témoignent du caractère
éphémère et illusoire des constructions de laboratoires, qu’elles concernent les partis politiques, les associations ou les médias.
Le cheptel politique qui sert de figurants pour théâtraliser l’illusion électorale à consommation extérieure est pour l’essentiel discrédité. L’indigence du personnel politique scotché aux sphères centrales ou périphériques du pouvoir est masquée par le peu de visibilité, pour ne pas dire l’opacité, qui affecte ces sphères. Prédateurs fonctionnaires, fourbes et ingrats, soumis sans être dévoués, ce qui est en cause ici ce sont, encore une fois, les mécanismes de cooptation qui, de la base au sommet de la pyramide, pourvoient aux fonctions d’autorité
en fonction d’une règle immuable : servir le chef du moment, quitte à le trahir à sa première déconvenue, obéir à une loi souvent non écrite, à une autorité souvent occulte, à un pouvoir de l’ombre. Le président en exercice a été lui-même victime de cet arbitraire dans les années 1980. Comme tant d’autres avant lui, il a certainement à coeur de vouloir le surmonter. Y parviendra-t-il ?
Sur la fermeture de chaînes de télé ou de journaux …
Nos luttes ont été dévoyées partout et l’argent a fi ni par avoir raison des plus téméraires. Cela me rappelle le pot de terre contre le pot de fer. La malédiction autoritaire qui a toujours prévalu (en dehors de la parenthèse de l’aventure intellectuelle de 1990-1991) développe une vision éculée des médias digne de la glasnost brejnévienne. Dans la pratique, loin du formalisme juridique de 2012, nous sommes encore à l’âge de l’article 12 du Code de l’information de 1982 qui énonce sans ambages que «l’information est un domaine de souveraineté nationale» et que «l’édition de journaux d’information générale est une prérogative du parti et de l’Etat». Cet énoncé juridique, momentanément battu en brèche par la loi de 1990, garde toute son emprise aujourd’hui. Dans un entretien pathétique avec un site électronique, un directeur de chaîne privée de télévision suspendue soutenait : «Nous travaillons dans la légalité.
Nous avons un registre du commerce, plus d’une centaine d’employés au siège (à Alger) et des correspondants à l’étranger.» La légalité se résume à si peu pour une raison qui sera dévoilée plus loin : «Quand la chaîne a été lancée, j’ai rencontré de hauts responsables dans les services de sécurité.» Avec une telle couverture, la procédure formellement requise devient superfétatoire et donne même des compétences à une représentation diplomatique en matière d’exercice des libertés dans le pays : «Nous avons déposé un dossier à l’ambassade de l’Algérie à Londres où se trouve le siège. J’ai donné une copie (du dossier) aux services de renseignements algériens et une autre au ministère de la Communication.» Le clou de l’entretien reste cet autre aveu : «On travaille dans l’informel comme toutes les autres chaînes de télévision parce que l’Etat veut travailler dans l’informel.» On mesurera par ailleurs l’emprise de l’argent qui a fini par vider le contrat originel issu des réformes introduites par la loi 90-07 du gouvernement Hamrouche en lisant le compte rendu des tractations en haut lieu en vue de l’acquisition par un hommes d’affaires de l’un des premiers titres – de langue arabe – datant de l’aventure intellectuelle dans notre pays. Ghania Oukazi dont le professionnalisme est avéré rapporte dans le Quotidien d’Oran du 13 octobre dernier «Il avait proposé d’acquérir le quotidien arabophone (…) dont les actionnaires avaient eu des problèmes entre eux» pour «mettre le journal au service du président-candidat au même titre que le quotidien francophone (…) dont il est le grand actionnaire». Voilà pourquoi je trouve que nous sommes dans une situation particulière où victimes et bourreaux appartiennent à la même famille, une situation dans laquelle il faut se garder «d’accuser ou de récuser des personnes en particulier», comme le suggérait Mouloud Hamrouche dans sa déclaration au forum du journal El-Hiwar le samedi 10 octobre dernier.
Quels enseignements en tirer ?
Le droit a échoué comme vecteur pour l’avènement d’un nouveau paysage médiatique ouvert, pluraliste, concurrentiel et transparent. Je vois à cela plusieurs raisons. D’abord, le mépris dans lequel le décideur algérien a toujours tenu la norme juridique, mise à son service exclusif. Ensuite, le peu d’effectivité du droit dans un système qui obéit à «la loi de la force» et non à «la force de la loi». Enfin, l’empressement de leaders des médias à servir vilement les maîtres du moment.
Quelles perspectives ?
Il faut prendre garde de s’associer à des processus ou ce sont les hommes qui sont incriminés et jamais les règles et les modes de gouvernance. La démarche qui prévaut actuellement dans les milieux politico-médiatiques bien pensants diffère sans cesse les chances d’alternance, elle fait la part belle à la «sacro-sainte règle de cooptation» dénoncée par Mouloud Hamrouche parce qu’elle est «demeurée stable et inamovible, (et) a empêché des hommes de réussir et des choix politiques, économiques d’aboutir.» Il le dit mieux que moi : «cette sacro-sainte règle sert à nourrir des rivalités et des luttes de clans. Elle a besoin de gardiens de temple pour fonctionner et les broyer pour survivre. Cette règle empêche les citoyens
et la société de s’épanouir, de se projeter et de se donner un destin. Pire, elle déstructure l’idée nationale, recrée des situations et des comportements qui poussent la société à reproduire son passé. Comme elle détruit la volonté nationale au profit des penchants régionalistes. Plus grave, elle livre notre religion et notre identité à des agressions et des régressions incommensurables.» On ne peut dire mieux .
© Par Ammar Belhimer, / El Watan Week-end
|
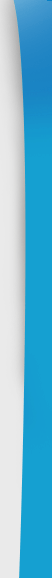 |