|
|
Mémoire- Entretien Daho Djerbal/A. Djelfaoui (Extraits de Africultures)
Date de création: 17-06-2018 10:13
Dernière mise à jour: 17-06-2018 10:13
Lu: 2210 fois
HISTOIRE- ETUDES ET ANALYSES- MEMOIRE- ENTRETIEN DAHO DJERBAL/A.DJELFAOUI (Extrait de Africultures)
Dans cet entretien en deux parties, Daho Djerbal nous invite à faire un tour de plus d’un siècle d’histoire contemporaine de l’Algérie et à méditer sur ce que furent les principales figures ou personnalités de cette époque que l’histoire écrite ou la mémoire collective ont retenues parmi d’innombrables autres. Le récit se poursuit ensuite sur la période de l’après-Seconde Guerre mondiale ainsi que sur les raisons profondes qui poussent à revivifier sur le temps long une partie (et pas une autre) de l’histoire en Algérie. Et ce qui est en train de percer de neuf…
Abderrahmane Djelfaoui
Ma question de lancement peut paraître banale mais mon constat est que la discussion publique de la question dite des «grandes personnalités» dans notre histoire a d’abord commencé autour de l’Emir Abdelkader avec des pointes du type : «Un homme d’Etat», «Lui et la franc-maçonnerie », «Damas»… Puis, progressivement, au fur et à mesure des années, le «débat» est remonté vers des personnalités de plus en plus contemporaines. Même quand ces personnalités ne sont plus tout à fait contemporaines, comme pour le film de fiction Lala Fathma N’soumer, ce sont des travaux de plus en plus fouillés, pointus ou plus humains qui émergent. Et, soudain, aujourd’hui, juste après la disparition d’Aït Ahmed, le débat sur tous les supports imaginables d’information a pris des proportions inouïes… Y a-t-il une raison qui fait qu’en Algérie ce débat soit plus aigu qu’ailleurs ?
Dans ta question, il y a plusieurs entrées. Evidemment, les personnalités qui ont marqué l’histoire ne sont pas nécessairement celles dont on parle. Il y a des personnalités qui ont été un peu mises de côté dans la mémoire collective. Donc, il y a des transmissions qui se font, des actes, des paroles d’un certain nombre de personnalités qui ont marqué l’histoire contemporaine de l’Algérie (on se limite à l’histoire contemporaine, n’est-ce pas ?), et il y a des personnalités qui ont marqué cette histoire mais qui ont été non pas marginalisées mais, en quelque sorte, omises, passées à la trappe de la mémoire. Elles restent de l’ordre du non-dit, du refoulé ou de l’oubli d’une certaine façon.
Donc, en fait, qu’est-ce qu’une personnalité ? En principe, la personnalité du point de vue de l’histoire, c’est un peu la même approche qu’on fait avec l’évènement. Il y a des évènements quotidiens qui disparaissent peu à peu de la mémoire, s’effacent, et il y a des évènements qui marquent et structurent le sens de l’histoire et qui sont transmis de manière transgénérationnelle, de génération en génération. Alors, de ce point de vue, y a-t-il des personnalités qui ont défrayé la chronique dont on a beaucoup parlé, puis qui passent de l’amnésie à l’hypermnésie ? Oui, il y a des personnalités qui, bien que surmédiatisées, ne sont pas marquantes du point de vue du temps long. Ce sont toutes ces précautions d’usage qu’il faut rappeler avant de parler de ces personnalités…
Personnalités, résistances et origines de l’Etat algérien au XIXe siècle
Comme tu as commencé par citer l’Emir Abdelkader, il faut dire qu’il a non seulement marqué son temps, mais aussi marqué la mémoire collective de tout un pays. Pour quelle raison ? Parce que d’autres personnalités de son temps ont aussi marqué l’histoire mais n’ont pas eu la même place. Je fais un cours en histoire contemporaine d’Algérie au cours duquel je parle de l’occupation militaire de l’Algérie par la France au XIXe siècle et des résistances. Ces résistances, il y en a eu partout dans le pays depuis 1830 jusqu’à la fin du XIXe siècle et même jusqu’au début du XXe siècle. Or, ces résistances n’ont pas eu toutes la même portée. On peut citer l’exemple de Boubaghla et d’autres résistants dont les noms vont me revenir… Mais Abdelkader a une place particulière comparativement à un autre personnage de son temps qui est Ahmed Bey et qui a aussi organisé et dirigé une résistance, plus longue d’ailleurs de trois années que celle de l’Emir Abdelkader, puisqu’il a commencé en 1830 et finit en 1848. Ahmed Bey a organisé et mené la résistance à l’occupation militaire française sous l’étendard ottoman, comme représentant d’un pouvoir souverain, celui de l’Empire ottoman.
Il a fait un appel à tous les notables, à tous les dirigeants du beylik de Constantine pour pouvoir mener cette résistance. Ce qui distingue l’Emir Abdelkader d’Ahmed Bey, c’est que l’Emir Abdelkader a été élu par ses pairs. En fait, c’est le premier homme d’Etat qui a été élu et, en même temps, c’est le premier chef et dirigeant d’une résistance qui a mis en place un pouvoir souverain, indigène, autochtone. Depuis trois siècles, l’Algérie ne connaissait pas de pouvoir souverain, autochtone. Depuis 1515-1525, le XVIe siècle, jusqu’au XIXe siècle, c’était un pouvoir non autochtone. Ce qu’il faut rappeler. Et ce pouvoir souverain, il l’a imposé par la lutte, par la résistance à l’Etat français qui a fini par le reconnaître avec le traité Desmichels, puis avec le traité de la Tafna, reconnaissant ainsi l’autorité de l’Emir Abdelkader sur un vaste territoire et une population. C’est devenu en quelque sorte un embryon d’Etat puisqu’il a commencé à mettre en place toutes les structures et toutes les institutions de la représentation du peuple souverain algérien autochtone vis-à-vis des Algériens et vis-à-vis du monde, puisque des traités ont été conclus, des accords, des conventions signées, etc. On comprend pourquoi cette personnalité s’est inscrite à la fois dans l’histoire et dans la mémoire, d’autant qu’elle a été au fur et à mesure ravivée, reprise comme modèle par le mouvement national naissant : l’Etoile nord-africaine en particulier, puis le Parti du peuple algérien, puis le FLN, puis l’Etat algérien qui en a fait un peu son icône. Au point qu’on a joué avec les mots un moment en disant : «L’Emir Boumediène et le Colonel Abdelkader.» Car c’est à l’issue du coup d’Etat de Boumediène que l’Etat avait institué une iconographie officielle de l’Etat algérien en renvoyant à la figure de l’Emir Abdelkader. Boumediène s’identifiait en quelque sorte à l’Emir Abdelkader, d’où la persistance de cette figure à la fois dans l’histoire (parce qu’elle a marqué l’histoire et structuré toutes les résistances par la suite) et elle a aussi restructuré la pensée commune, identitaire par rapport à ce qu’a été l’Algérie au XIXe siècle assujettie à l’Empire ottoman puis qui bascule dans l’organisation d’une large résistance autochtone à l’invasion des armées françaises…
Par contre, les autres résistances étaient des résistances à l’arrivée des troupes de l’armée française dans les régions qui les concernaient ; elles étaient locales, à la limite régionales ou interrégionales mais pas plus, et il n’y a pas eu, comme pour la résistance de l’Emir Abdelkader, de mise en place d’embryon d’Etat, que ce soit à un niveau institutionnel, culturel ou religieux, etc. On comprend ainsi pourquoi la personnalité de l’Emir Abdelkader s’est inscrite dans la durée.
D’autres personnalités ont connu un sort moins important, pour ne pas le qualifier autrement, que celui de l’Emir Abdelkader, et pourtant leur résistance a marqué. Tu as parlé tout à l’heure de Lala Fathma N’soumer. Elle a été longtemps omise. Elle est restée dans la mémoire collective d’une région, mais pas de toutes les régions du pays. Et cette région l’a tout le temps réanimée, ravivée par le conte, par la poésie, par la chanson et par un certain nombre d’autres manifestations rituelles. Je dirais plus tard pourquoi aussi certaines personnalités n’ont pas connu le sort, la même glorification que certaines autres.
L’Emir Khaled, figure historique du début du XXe siècle
Parlons maintenant de la figure de l’Emir Khaled au début du XXe siècle, c’est-à-dire d’une période de l’histoire contemporaine allant de 1912 à 1923, puis 1927 jusqu’à 1943. Le fait est que l’Emir Khaled a repris le flambeau de l’Emir Abdelkader. Petit à petit, passant de sa position de petit-fils héritier de l’Emir Abdelkader, il a pu bénéficier des accords qui ont été signés avec Lamoricière pour la fin des hostilités, la fin de la résistance. Il a bénéficié des prébendes qui étaient concédées à la famille et aux descendants de l’Emir Abdelkader. Son père, Mahieddine, était le fils de l’Emir Abdelkader et recevait une pension importante. Ce père a donc pu placer son fils au lycée Louis le Grand à Paris puis à Saint Cyr. Il est sorti des grandes écoles françaises officier de l’armée française. Il a même été en 1912 au Maroc, sous les drapeaux français, pour combattre la résistance marocaine. C’est là qu’il a rencontré son oncle, l’Emir Abdelmalek qui lui a dit : «Rappelle-toi d’où tu viens. Rappelle-toi qui tu es, quel nom tu portes…»
Et là, le général Lyautey, qui était le représentant de l’autorité française d’occupation au Maroc, ayant appris cette rencontre avec l’Emir Abdelmalek qui dirigeait la résistance dans les frontières algéro-marocaines depuis Marrakech jusqu’au Rif, – en fait toutes les communautés, les tribus de la région ont suivi l’Emir Abdelmalek –, il y a là un tournant pour l’Emir Khaled. Il a alors été l’objet de remontrances et d’une dégradation par le général résident Lyautey, ce qui l’a amené à prendre conscience qu’il n’était qu’un indigène, et non un simple sujet ou citoyen de la France.
Il a demandé à être mis à la retraite anticipée de l’armée française et il a rejoint les Jeunes Algériens, un mouvement qu’il a ensuite dirigé, en lançant le journal El Ikdam, avec des positions combatives. Ses listes ont été élues dans la plupart des élections municipales de 1919-1920 en Algérie où il était revenu après avoir fait la campagne du Maroc. Dans El Ikdam, il dénonçait les abus de l’administration coloniale, tout comme il dénonçait les collaborateurs de l’administration. Il a commencé à être un élément gênant. Mais en même temps dans cette aura d’être le fils de l’Emir Abdelkader, il s’était dépareillé de son uniforme militaire et avait mis le vêtement traditionnel algérien : el gandoura, el-âbaya, le chèche et s’était laisser pousser sa barbe… Au fond, sur le plan sémiotique, celui des signes, comme dirait l’historien Omar Carlier, il est un peu rentré dans l’histoire comme l’héritier de la résistance. C’est à ce titre que partout où il allait faire sa campagne électorale, pour lui ou pour soutenir les gens de sa liste électorale, à Constantine, dans l’Oranie ou dans l’Algérois, il y avait des rassemblements de masse importants. En fait, il avait réanimé l’esprit de la résistance et la conscience des Algériens d’appartenir à un ensemble qui est occupé et dominé par une puissance étrangère.
C’est ainsi qu’il est assigné à résidence par le gouverneur général de l’Algérie entre 1921 et 1923. Partout où il était assigné à résidence dans l’Est algérien, à Oum El Bouaghi, puis dans l’Algérois, à Ksar El Boukhari, à Bou Sâada et dans d’autres régions, partout il y avait des rassemblements de masse où on venait lui rendre visite comme le représentant ou la personnification de cette résistance. Donc cette personnalité a marqué. En 1923, il est banni d’Algérie et assigné à résidence à Alexandrie. En 1924, du fait de l’arrivée du bloc des gauches en France qui ordonne une amnistie générale pour tous les détenus politiques, il repart à Paris. Et c’est à ce moment-là qu’on le sollicite pour être le président d’honneur de l’Etoile nord-africaine qui se fonde en 1926.
L’Emir Khaled est donc une figure très marquante, mais qui n’a pas la même place dans l’imaginaire, dans la mémoire et l’iconographie de l’Etat algérien que celle de l’Emir Abdelkader.
L’image des collaborateurs…
Il y a aussi l’autre versant des figures. Celles des auxiliaires et des collaborateurs. Tout le monde, du point de vue de la mémoire collective, se souvient d’une expression qui a fait rentrer dans l’histoire le personnage du colonel Bendaoud : «Aarbi, âarbi ou loukan colonel Bendaoud.» Ce Bendaoud, c’était effectivement le premier officier supérieur de l’armée française qui avait atteint le grade de colonel au début du siècle. Ce colonel Bendaoud, qui avait ouvert des centres de bienfaisance en Oranie qu’on appelait les maisons Bendaoud, est entré dans la mémoire collective mais n’a aucune place dans l’histoire. Il n’y a aucun travail de recherche historique autour de ce personnage. C’est le contre-exemple de la figure glorieuse d’autres personnages ; lui n’a pas eu de place dans l’histoire. Il n’empêche que c’est une personnalité. Le colonel Bendaoud a fini par se suicider. Parce qu’il s’est rendu compte, et c’est son expression avant le suicide : «Aarbi âarbi ou loukan colonel Bendaoud…», que quel que soit son rang, quel que soit son grade, c’était un Arabe, et c’était toujours un subalterne. Tu avais aussi évoqué au début le nom de Bengana. Bengana était Cheikh Laârab.
C’était le représentant de toutes les tribus et communautés arabes du Constantinois auprès de Salah Bey puis de Ahmed Bey. Ce n’était donc qu’un auxiliaire de tous les Etats centraux, qu’ils fussent ottomans ou coloniaux français après la chute de la Régence d’Alger ; ça a continué. Donc au fond, Bengana, la famille Bengana par la suite, a été marquante du point de vue de l’histoire, mais a disparu de la mémoire. Ce qui en est resté, c’est simplement les Bengana aristocrates, riches milliardaires et plus ou moins notables des grandes villes comme Alger où ils ont des biens immobiliers considérables. Villes où il y a des héritiers qui se disputent les héritages des Bengana un peu partout dans le fahs, c’est-à-dire sur les hauteurs d’Alger. Cela aussi est ignoré dans l’histoire, en dehors de quelques monographies de la famille qui sont restées et qu’on peut retrouver dans les archives. Peu de travaux et peu de choses sont restés pour ces grandes figures. Grandes non pas en termes de gloire, mais en termes de contradictions de l’histoire à la fois du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècles. Egalement pour ce qu’il en est d’une personnalité comme celle de Tamzali… ou Hamoud Boualem, ou encore les Hafiz, les Belhafaf, grandes familles d’Alger comme on peut citer d’autres grandes familles de Constantine, de l’Oranie, de Tlemcen, de Mazouna, de Mostaganem et d’autres régions d’Algérie. Tout cela a été un peu voué à l’oubli ou minorisé.
Est-ce qu’on peut dire que la raison de cette situation relève de la faiblesse notaire de travaux de recherches académiques ? Est-ce une question d’imprégnation et de contrôle idéologique des institutions ?
Non, c’est autre chose qui va travailler cette histoire. Ce qui va la travailler, c’est l’histoire de la résistance. Au fond, la figure exemplaire, celle qui mérite d’être mémorisée, c’est la figure du porteur d’armes. C’est elle qui est animée et réanimée à chaque fois par l’évènement historique. Déjà, durant la Seconde Guerre mondiale se crée le Comité d’action révolutionnaire nord-africain (CARNA). Un Comité au sens algérien plein du terme. C’est l’héritage de l’Etoile nord-africaine qui fait qu’on ne pense entrer dans la lutte armée qu’à l’échelle maghrébine. Ses membres vont se former militairement pour entrer dans la lutte armée. Et il y a déjà des incidents…
C’est l’ancêtre de l’OS ?
Absolument, puisqu’un des membres du CARNA était Belouizdad et les jeunes de Belcourt, dont Yousfi et d’autres. Ils deviendront des membres éminents de l’OS. Il y a donc des continuités… C’est ce qui fait que la figure du résistant, la figure du porteur d’armes va l’emporter sur l’image de l’homme politique ou l’homme de culture. Parce que concernant les hommes de culture, il y a eu aussi des noms importants, des personnalités. Je prends Berrahal ou plutôt d’autres noms qui ont marqué leur époque. Le Docteur Benaouda Benzerdjeb à Tlemcen ou les frères Omar et Mohamed Racim à Alger ou d’autres qui sont un peu au-dessous d’autres personnalités qui ont été très marquantes dans la période de l’entre-deux guerres mondiales, les années 20-30 et sur lesquelles malheureusement il existe peu de monographies, peu de travaux quant à leur importance, leur apport réel. Les raisons qui expliquent cela sont, à mon avis, de deux ordres. La première, c’est petit à petit la focalisation de la mémoire et de l’imaginaire sur le porteur d’armes et cela depuis le XIXe siècle, depuis l’histoire des résistances. Ainsi, ce qui est passé dans l’histoire, ce n’est pas la figure des Ikhouane essafa, el moutassaouifine, comme l’Emir Abdelkader, des zaouïas, des confréries, etc., mais des hommes en armes, l’image des maquis, y compris celle des bandits d’honneur, mais qui sont aussi des figures mineures. Parce que le bandit d’honneur, c’est quelque part quelqu’un «elli kharedj âa ettrik», «guettaâ ettrig»…
Ce travail de survalorisation de certaines figures dans l’histoire et la mémoire renvoie en fait à l’anthropologie, à l’histoire de la culture collective. Pourquoi l’anthropologie ? Pour expliquer cela, il faut mettre en lumière la question du patriarcat. Autrement dit, ce dont il est question, c’est la figure du père fondateur qui sera passé du wali (oulid flen ou sidi flen) au résistant, au moudjahed. Mais, parfois, les deux figures se rassemblent, se fondent quand il s’agit de leadership, comme pour ce qui est de la figure de Messali Hadj. Pourquoi ? Parce qu’il a à la fois l’image, le «charisma» du père fondateur du mouvement nationaliste, mais aussi l’image de celui qui va ouvrir la voie, une perspective.
Donc, pas uniquement sur le plan strictement politique, mais aussi sur le plan des valeurs et des questions identitaires, en s’habillant d’une certaine manière, en faisant la prière...
Exactement. Donc il va revêtir au fur et à mesure les oripeaux, les vêtements, l’image du père fondateur. Cela est très important.
C’est particulier à la trajectoire de l’histoire patrimoniale culturelle des Algériens ?
Absolument… On dit que c’est la fusion des deux figures, celle du résistant porteur d’arme (la statue de l’Emir est inséparable de l’épée qu’il brandit… et quasiment jamais le livre) et celle du père fondateur. Maintenant, on va voir pourquoi ces deux figures vont se séparer à un certain moment.
Un autre élément est aussi le Livre, non pas le livre ordinaire, mais le livre avec un L majuscule : le Coran.
Le Livre sacré…
Oui. Et là va apparaître la figure de Ben Badis qui va l’emporter et jeter de l’ombre sur d’autres figures aussi importantes, sinon plus importantes que lui dans la fondation du mouvement des Oulémas algériens. Tayeb El Okbi, par exemple. Cheikh Ezahiri ou d’autres maîtres du mouvement réformiste religieux qui sont passés plus ou moins dans l’oubli et qui sont restés des figures locales ou régionales de certaines villes. Donc, au fond, les personnalités tournent autour de ce triptyque : le porteur d’arme qui est aussi le père fondateur (el-ab el-mouassass) et l’homme de religion.
C’est à dire Le commentateur du Coran…
L’homme de religion est la figure de la foi, de la pratique religieuse d’une certaine façon et de la réforme. Donc, au fond, c’est autour de ces trois figures que l’on va voir s’organiser l’apparition de personnalités. Ces personnalités vont poser problème, comme Aït Ahmed que tu as cité tout à l’heure. Prenons le traitement surmédiatisé fait sur la mort de Aït Ahmed. Ainsi, par cette mort, on va se retrouver avec le retour au père fondateur. Pourquoi ? Parce que, dans la mort, il va revêtir le manteau de At Ahmed, c’est-à-dire du wali père fondateur de la zaouïa des Aït Ahmed. Ça c’est dans l’impensé ; dans l’inconscient collectif. Car tout ce rassemblement, c’est un peu une ziara surmultipliée.
C’est-à-dire qu’inconsciemment, il y a une sorte de répétition compulsive de quelque chose qui a été perdu. Et donc, pour renouveler comme fondement et comme ciment de la communauté, il faut une figure. Cette figure va jouer le rôle de rassemblement, à la fois de rassemblement de lewtan (c’est-à-dire du terroir), mais d’el-watan, national. C’est cette double dimension qui est travaillée. Mais en même temps, cette figure du père fondateur n’est pas seulement la figure de la communauté confrérique, de la communauté tribale en quelque sorte (un terme que je n’aime pas beaucoup), mais c’est aussi l’image du père fondateur du Front des forces socialistes.
Communauté tribale dont il n’existe plus en fait que des restes. C’est cela ?
Absolument. C’est dans l’imaginaire, d’autant plus que dans l’histoire la réalité tribale est en voie de disparition ! Pourquoi ? Parce que quelque chose qui disparaît sur le plan matériel, sur le plan des structures, etc., il y a une exacerbation du point de vue du discours, de la mémoire et de la représentation. La représentation a lieu par défaut de la reconstitution même du groupe. C’est très important.
Donc, au fond, c’est par la perte, par défaut, qu’on met en valeur et qu’on survalorise la figure d’une personnalité qui va jouer le rôle de revivification de quelque chose qui a été perdu…
A ce propos, je tiens à rapporter ici brièvement un évènement dont j’ai pris connaissance lors d’un de mes voyages à Tlemcen. Le guide, un vieil intellectuel de la ville qui me fit visiter les hauteurs et les vestiges antiques romains et phéniciens à flanc de montagne, m’amena sur une esplanade où se rencontraient régulièrement des poètes que rassemblait Moufdi Zakaria, alors militant du PPA. Cette esplanade jouxte l’humble mausolée d’un saint très connu qui domine la plaine. Mais bien plus, il m’apprit que dans la courette même à l’entrée de ce wali Emilie Busquant, l’épouse de Messali Hadj (souvent emprisonné, déporté ou assigné à résidence), réunissait pour les nécessités du travail du parti les femmes des militants loin des yeux et des oreilles des autorités coloniales…
Ça rejoint et recoupe ce que je dis. C’est ce qu’on appelle des lieux de mémoire. Et dans ces lieux de mémoire, comme dirait Abderrahmane Moussaoui, l’anthropologue : «L’espace, le lieu, c’est du temps coagulé.» Car il se trouve en ce lieu quelque chose qui est mythique, de l’ordre de l’imaginaire et renvoie à toute une histoire de quelque chose qui est révolu. Mais parce que c’est révolu, il faut le faire re-vivre. A chaque fois d’une manière cyclique. Eziara oua el-ouaâda procèdent de ce sens-là.
Donc, en revenant à Aït Ahmed : père fondateur de la zaouïa, père fondateur aussi d’une certaine façon de l’OS, puisqu’en 1948 il présente un rapport du parti qui se tient à Zedine sur l’OS et il prend la succession de Belouizdad. Il est un des pères fondateurs de l’OS avec Belouizdad, Ben Bella et d’autres personnages comme Mahsas, M’hamed Yousfi, etc. Un rapport qu’il a rédigé et qu’on lui attribue, mais, en fait, si c’est bien lui qui l’a présenté à Zedine, il n’est pas le seul à l’avoir rédigé. Ce qui est un détail…
Pas seulement un détail, puisqu’il signifie que ce travail était collégial.
Au lendemain de la mort d’Aït Ahmed, le journal Liberté titre de façon extraordinaire (parce que ça résume un peu tout ce que je suis en train de dire) cette personnalité en le qualifiant : «Le père fondateur du nationalisme algérien»…
On passe aux oubliettes l’autre…
Absolument. Au lieu de dire UN des pères fondateurs, il devient Le père fondateur. C’est un peu ce sens-là que je suis en train de travailler actuellement sur ma réponse à la question que sont les personnalités…
C’est-à-dire que certaines personnalités vont jouer leur rôle ou permettre une actualisation de quelque chose qui est dans l’ordre de la représentation collective. 1 : père fondateur. 2 : porteur d’armes (puisqu’en 1963 ce sont les maquis du FFS). Il quitte donc sa fonction d’homme politique, de penseur, d’un des planificateurs de la Révolution et concepteur, disons, de certaines positions de la Révolution algérienne dès avant-1954, pour être porteur d’armes en 1963.
D’ailleurs, dans l’iconographie que la presse ou les réseaux sociaux reprennent aujourd’hui, on le voit en treillis militaire avec une casquette à côté de Mohand Oul Hadj ou d’autres chefs de la Wilaya III, etc. Donc, au fond, la figure d’une personnalité (c’était la question posée au départ), il faut l’observer à travers le temps moyen, le temps long.
Il y a une transformation au cours de l’histoire…
Aussi, à travers l’instrumentalisation qu’on fait du temps présent. Parce que le temps présent, c’est à la fois une lutte d’influence, une lutte de représentativité d’une région, d’une localité. Ainsi, en Kabylie, depuis deux ou trois ans, chaque localité prétend être le foyer de la résistance ou le fief de la résistance et de l’opposition. Il y a Draâ El Mizan, Larbâa Nath Iraten, Aïn El Hammam, l’Akfadou… Chacune prétendant être Le fief de la résistance et de l’opposition. Et c’est vraiment ce travail du temps présent qui est un travail politique. C’est plus un temps politique qu’un temps mémoriel. Les personnalités qu’on voit mettre en avant sont des personnalités qui vont servir de prétexte, d’effigie ou d’arguments pour légitimer les positions actuelles.
Maintenant, pourquoi ces figures sont principalement des figures masculines ? C’est parce que la structure sociale est patriarcale. Mais c’est un patriarcat qui est mis en difficulté, qui est mis à mal par la montée des femmes dans l’espace public, dans l’espace professionnel, dans la visibilité sociale. Cela pose un énorme problème, d’où la revivification…
Même à outrance…
Exactement. L’exacerbation de la figure du maître, de la figure du chef, de la figure du commandant, de la figure du penseur religieux… Parce que déjà commence à se poser dans l’espace religieux le problème du prédicat, des prédicateurs. Le prédicateur a toujours été un homme. Mais dans l’histoire, pas toujours. Dans l’histoire, on retrouve des régions, comme au Djebel Nefoussa, par exemple, dans le Sud tunisien, Sud libyen et Sud algérien où il y a des traditions matriarcales qui ont fait que parfois une femme est devenue imam ; une femme elli tefti et qui dirigeait la prière. Donc, du point de vue des traditions religieuses, ce n’est pas exclusif.
Comme dans la tradition historique de l’islam à certaines périodes et en certains lieux…
Exactement. Donc, pourquoi la figure de la femme n’est pas considérée comme une personnalité ? Dans l’inconscient de la question, c’est uniquement les mecs. Voilà toute ma réponse à cette question-là.
C’est une réponse d’ensemble qui est très intéressante. C’est une vue qui révèle la complexité des intrications de l’histoire réelle. Mais sur ce fonctionnement plus ou moins inconscient et arbitraire des questions de représentation, est-ce qu’il y a aujourd’hui (plus qu’hier) un travail de recherche ? Que ce soit à l’université, de la part de chercheurs indépendants, dans la littérature, le cinéma, de la part d’essayistes ? Ou est-ce que ce travail inconscient est laissé totalement livré à lui-même dans notre société ?
Le fait est que l’espace universitaire n’est pas encore un espace différencié par rapport à la société, parce que la société traverse de part en part l’université et fait que l’université ne s’est pas encore posée en tant que pôle ou centre de travail sur l’histoire, sur l’image. Cela fait globalement que les travaux universitaires en Algérie depuis quelques décennies ne sont que des redites de ce qui domine dans la société. Il n’y a pas de distance critique, pas de remise en question, d’autant que les staffs, les directions de recherche, les conseils scientifiques sont dominés par des gens d’appartenance. Donc ceux qui veulent faire une démarche académique, ne serait-ce qu’un travail de type positiviste, de terrain, de monographies, ceux-là sont plus ou moins marginalisés, mis à l’écart. Ils sont contraints à partir en exil, travailler ailleurs, faire leurs thèses à l’étranger. Je pourrais donner des tas d’exemples, mais peu importe, ce n’est pas cela le propos… Ce qui domine dans la production éditoriale, ce qui domine l’édition et la diffusion du livre, ce sont les ouvrages, les travaux réalisés en dehors de l’université. Très peu de travaux universitaires sont édités. Donc, l’université n’a pas encore pris pied dans la diffusion, la transmission des valeurs et savoirs, fussent-ils scientifiques, académiques ou autres. Cela est aussi vrai pour la production cinématographique. Dans la plupart des réalisations de fictions historiques, ou de type documentaire, il y a excessivement peu, presque pas, quasiment pas d’appel à des spécialistes, des gens qui les aideraient à élaborer un scénario, une trame qui serait fondée sur un travail historique réel. D’où un tas d’inconséquences, de contradictions, de contresens historiques dans la plupart des productions cinématographiques algériennes.
Bio express de l’historien
Maître de conférences en histoire contemporaine au département d’Histoire, Université d’Alger II, Daho Djerbal est, depuis 1993, directeur de la revue Naqd, d’études et de critique sociale. Après une dizaine d’années de travaux en histoire économique et sociale, il s’oriente vers le recueil de témoignages d’acteurs de la lutte de Libération nationale en Algérie. Il travaille aussi à la relation entre Histoire et Mémoire. Il a publié en 2012 L’Organisation spéciale de la Fédération de France du FLN, 448 pages, aux éditions Chihab (Alger). |
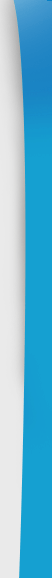 |