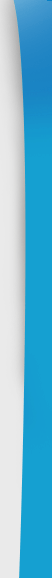Presse algérienne: suspicion et paradoxes. Par Ahmed Cheniki, universitaire, journaliste
La presse est, depuis l’avènement du multipartisme, le centre d’intérêt particulier des espaces politiques et médiatiques. Ces derniers temps, quelques ouvrages traitant de cette question réduisent souvent l’appareil médiatique à des espaces politiques. Il est même arrivé à des universitaires algériens d’user, à partir de l’étranger, d’abusives généralisations et de rapides conclusions.

De trop nombreux universitaires, «spécialistes» de l’information dans certains départements de communication, ignorent complètement le fonctionnement de l’univers médiatique en Algérie, utilisant souvent comme arguments des lieux communs et des formules stéréotypées, à l’image de départements de communication manquant tragiquement de spécialistes et englués dans un sociologisme vulgaire. Certes, quelques noms, très rares, proposent d’excellents travaux, à l’instar de Ahcène Djaballah, Gacem, Brahim Brahimi, Belkacem Mostefaoui, Rezagui et Ihaddaden. Le militantisme prend le dessus sur la formation universitaire.
Ces discours peu fouillés et marqués par une sérieuse indigence sur le plan de la méthode, obéissant essentiellement à des besoins immédiats, faussent le débat sur la presse en Algérie, encore peu connue et peu étudiée par les universitaires algériens et étrangers qui, souvent, se limitent, quand ils évoquent la presse, à des clichés et à des stéréotypes concourant à l’altération de la communication. Un discours univoque marque le terrain et traduit une méconnaissance presque totale du fonctionnement de cet appareil traversé par de multiples contradictions et vivant une situation équivoque, marquée du sceau de la suspicion par les partis et les gouvernants. On parle de plus en plus de la naissance de la presse privée qui serait l’apanage d’une génération spontanée, ignorant les combats et les luttes anonymes de nombreux journalistes défendant, entre chapelles politiques diverses et propagande officielle, leur métier, en dehors des compromis et des calculs des espaces partisans et des interminables tentatives de récupération. La presse n’est nullement le lieu exclusif de journalistes partisans, mais comporte également de nombreuses plumes sans lien direct ou indirect avec les lieux politiques dominants ou d’opposition.
On y trouve des fonctionnaires zélés, des opportunistes, des khobzistes, de véritables professionnels, des agents des services, des militants de partis… Les choses sont très complexes. Déjà bien avant 1988, de nombreux journalistes ont connu la censure, l’interdiction d’écrire, le licenciement et l’arbitraire. Un regard rapide de l’histoire de la presse depuis 1962 donnerait une certaine idée de la complexité du monde journalistique. Il est faux d’affirmer, comme semblent l’avancer certains universitaires et journalistes algériens et étrangers, que tous les journalistes reproduisaient le discours officiel qui, d’ailleurs, se caractérisait par de très profondes ambiguïtés. Plusieurs discours investissaient l’univers journalistique, comme d’ailleurs l’espace du pouvoir. Ces attitudes paresseuses et confortables posent le problème du manque de sérieux de nombreuses recherches universitaires, piégées par les jeux de confortables généralisations et de la reproduction de discours et de thèses préalablement mis sur le marché. Une lecture de la presse montrerait la multiplicité des ancrages idéologiques et la pluralité des styles journalistiques.
Quelques expériences comme celles de Révolution Africaine (1963-1965 et 1985-1988), de La République, d’Algérie-Actualité (1978-1984) et d’ Echaab (1975) ou d’ El Moudjahid du temps de la direction de Abdelaziz Morsly ont quelque peu accordé un certain intérêt à l’écriture journalistique proprement dite rompant avec les scories de la glose politique. Certes, de nombreux journalistes —certains d’entre eux se sont d’ailleurs convertis dans l’opposition — fonctionnaient comme des porte-valises d’hommes du gouvernement. Ce n’est que vers les années 1970 que les choses allaient commencer à changer avec l’arrivée, dans la presse, de jeunes licenciés qui, enfin, se mettaient à écrire lisiblement et à entreprendre une certaine révolution dans le métier jusque-là squatté par des «anciens» débarquant souvent par hasard dans ce métier. La contestation avait pignon sur couloirs des rédactions. Les journalistes protestaient contre la ligne éditoriale, désavouaient leur direction comme lors des événements de Tizi-Ouzou de 1980, de la publication de l’interview réalisée par un certain Lotfi Maherzi avec le tortionnaire Marcel Bigeard en 1984 et des événements tragiques d’octobre 1988.
Des journalistes qui avaient souffert des listes noires, des suspensions répétées, des licenciements et de la privation du logement revendiquaient ouvertement le droit à la parole et à l’information, au grand dam de leur direction et d’autres journalistes carriéristes, souvent sans qualité. Mais cette légitime revendication allait être court-circuitée par des forces politiques, dans et en dehors du pouvoir qui faisaient entrer en jeu les calculs et les compromis politiques. C’est dans ce contexte que le Mouvement des journalistes algériens (MJA) qui, même noyauté, constituant au début un lieu de prise de parole, était né. Vite infiltré et sérieusement vidé de son contenu initial, il devenait tout simplement un lieu de rencontres de forces politiques où s’affrontaient sans rémission diverses sensibilités, marginalisant la parole professionnelle. Mouloud Hamrouche, alors à la Présidence, avait saisi l’importance de ce mouvement qu’il se mit, lui aussi, à encourager timidement.
Mais jamais, le MJA n’a évoqué, ne serait-ce qu’une fois, l’éventuelle émergence d’une presse privée dont il combattait violemment l’idée avant que nombreux de ses dirigeants ne se voient devenir patrons et associés dans des entreprises de presse, soutenues au départ par Hamrouche notamment qui voyait peut-être dans la presse un possible soutien à ses futures ambitions politiques. La circulaire de mars 1990 et la loi sur l’information du 3 avril 1990 permettaient à des collectifs de journalistes de créer leur propre journal. C’est ainsi que le Jeune indépendant, le Nouvel Hebdo, le Soir d’Algérie, El Watan, El Khabar et Alger-Républicainvoient le jour. Ces journaux se composaient essentiellement d’associés venus du secteur public, sauf le Jeune indépendant et le Nouvel Hebdo, association d’un industriel Tahar Soufi, Kamel Belkacem et Abderrahmane Mahmoudi. Le Nouvel Hebdo disparaîtra après un conflit entre Kamel Belkacem et Soufi. Mais durant cette période du début de la presse privée qui s’était autoproclamée «indépendante», la presse publique connaissait une véritable hémorragie et une grave instabilité.
D’ailleurs, de nombreux titres disparaîtront comme Algérie- Actualité (qui fut dirigé par un incompétent notoire dont personne ne retient le nom après la démission de Abdelkrim Djillali qui avait refusé de licencier SAS comme le lui avait demandé le ministre de la Communication de l’époque), Parcours Maghrébins, Essalem et bien d’autres titres publics comme des journaux privés comme l’Hebdo Libéré, la Nation et de trop nombreux autres titres ne résistant pas aux pressions commerciales. Parcours Maghrébins avait été placé en enfer en plaçant à sa tête un inconnu, sans qualités, après le départ de Ahmed Benalam. Les organes de la presse publique sont souvent dirigés par des noms trop peu crédibles. Les nouveaux titres privés étaient aidés directement et indirectement par le gouvernement jusqu’à la première moitié des années 1990, à tel point que certains journaux ne pouvaient pas égratigner le gouvernement. D’ailleurs, quand le Nouvel Hebdo avait eu des problèmes, un quotidien francophone aurait refusé, selon son directeur de rédaction, Abderrahmane Mahmoudi (cité dans son dernier ouvrage) de publier un encart publicitaire, de peur de mécontenter Mouloud Hamrouche. L’ancien Premier ministre avait placé ses proches à la tête de la grande partie des médias publics et a tenté de séduire les journaux privés. Les journaux allaient bénéficier de facilités bancaires, d’espaces publicitaires généreux et de nombreux avantages qui allaient permettre à ce qu’on avait abusivement appelé «aventure intellectuelle» de décoller et de se frayer un chemin dans l’espace médiatique. Les titres se mettaient à s’attaquer aux Enamep (entreprises publiques de diffusion).
Vite, des diffuseurs privés prenaient le relais. El Watan et El Khabar créent leur propre société de diffusion, à Oran et à Constantine. Les journaux privés commençaient à gagner le public marginalisant les journaux du secteur gouvernemental, souvent lieux de propagande et manquant de sérieux, surtout après le départ de trop nombreux journalistes à la suite de la mise en application de la loi de 1990 qui permettait la constitution d’organes privés. Malgré tout, les journaux privés occupaient une brèche et se permettaient de soulever certains problèmes et de mettre à nu quelques dysfonctionnements. Au début, les choses tâtonnaient. Les uns et les autres reprenaient en fait la manière de faire des journaux publics de l’époque. Ils cherchaient aussi à reproduire des modèles français comme pour El Watan qui avait cherché à retrouver la sobriété du Monde ou le Matin, issu d’une scission avec Alger-Républicain, reproduisant le schéma du quotidien français du même titre. Les journalistes d’ El Khabar avaient surtout profité de l’expérience d’ El Massa qui favorisait le reportage et l’enquête à un certain moment de son histoire, choses que nous ne retrouvons plus dans El Khabar d’aujourd’hui ou des journaux sans consistance réelle comme Echourouk. Mais la pluralité des associés (certains journaux ont démarré avec une vingtaine d’associés-journalistes) est à l’origine de multiples crises à l’intérieur de certaines rédactions. La gestion anachronique de l’espace physique du journal est symptomatique d’une absence de vision de l’ensemble rédactionnel. Le discours est biaisé, neutralisé par une déficiente hiérarchisation de l’information et une mise en espace donnant parfois de l’importance à des faits trop peu affirmés, se transformant en un espace archéologique.
La pauvreté des pages culturelles, quand elles existent, un fourretout, sans une occupation minutieuse de l’espace, est significative d’incohérences au niveau du discours éditorial. Le choix de l’espace à occuper devrait être important, en exigeant un nombre de signes précis et une surface particulière correspondant à l’importance du texte et de l’info sans l’économie générale du journal. L’espace médiatique allait connaître une profusion de titres. Les uns ont bien résisté malgré les bourrasques et les tempêtes commerciales tandis que d’autres sont morts tout simplement pour des raisons commerciales, même si certains titres, qui n’avaient pas payé leurs dettes jusqu’à présent aux imprimeurs, invoquaient les illusoires pressions politiques. Certes, des conflits et des accords ponctuels alternaient dans les relations presse privée-pouvoir. Des titres ont été suspendus, des journalistes sont condamnés. Le quotidien était fait de flirts parfois bien entretenus et de coups de gueule sans lendemain. Ce qui est nouveau, c’est que le gouvernement avait de plus en plus peur des attaques de la presse privée qui devenait parfois une sorte de contre-pouvoir. C’est l’un des éléments positifs de cette «nouvelle» presse qui ose parfois perturber certaines réalités. Mais souvent, on retrouvait les luttes partisanes à l’intérieur de la rédaction et de l’espace du journal.
Chacun, usant de qualificatifs, trop nombreux, et défendait sa chapelle politique. Des journalistes reprenaient parfois sans un regard critique des informations parvenues à la rédaction de sources proches d’un clan ou un autre clan du pouvoir ou de l’opposition. La rumeur faisait le reste. On a affaire à un journalisme de bureau où parfois les pages nationales, par exemple, reproduisent le même article sous des signatures différentes. Les journaux s’imitent, se reproduisent à tel point que le ratage est défini comme le fait de ne pas avoir donné la même information qu’un autre journal. Il est à noter la reprise in extenso de dépêche d’agences de presse étrangères sans une interrogation de la source et sa mise en conformité avec la «ligne éditoriale». Faire un journal à moindres frais, tel est le souci de nombreux éditeurs qui accordent peu d’importance à la qualité professionnelle et à l’investigation. L’espace est souvent mal géré, ignorant les contingences spatiales, la hiérarchisation de l’information et la configuration géométrique. Des journalistes interviennent quotidiennement, ce qui fragilise leur discours et rend peu crédible leur communication. On écrit sur tout en cherchant souvent, pour certains, à séduire leurs proches, en usant d’expressions et d’un lexique singulier, inabordable pour la moyenne des lecteurs.
Le style trop narratif pose problème, comme d’ailleurs cette absence flagrante de distance avec les faits, confondant commentaire, information, reportage, enquête… Les partis-pris, le manque de vérification de l’information, la précipitation, le trop-plein d’adjectifs qualificatifs et d’adverbes, les nombreux problèmes techniques et linguistiques marquent une presse qui, dans de très nombreux cas, ne dépassent pas la capitale faisant des «bureaux régionaux» et des correspondants souvent non payés, usant de leurs cartes de presse pour impressionner responsables et relations, des lieux de collecte de la publicité ou de simples «remplisseurs» de pages peu sérieuses s’appropriant un titre très grave : «Algérie profonde » considérée comme secondaire. De nombreux bureaux régionaux vivent mal cette situation. L’information de proximité est souvent sacrifiée au profit des jeux d’appareils comme si l’Algérie se réduisait à quelques hommes «politiques». C’est l’information à moindres frais. Seul un ou deux quotidiens possèdent de véritables rédactions régionales. Sans compter le problème de la publicité qui rend le journal prisonnier de son bailleur de pubs. Qui osait et/ou qui ose critiquer Khalifa, certains concessionnaires automobiles, les opérateurs de téléphonie mobile ou des compagnies aériennes ? Il est plus confortable de s’attaquer au «pouvoir» politique qu’aux lieux du pouvoir économique. Mais ce qui pose problème, c’est la concentration d’un même titre entre les mains d’une même personne. Cette situation est dangereuse et porte préjudice au droit à l’information du citoyen qui se retrouvera avec des organes de presse prisonniers du discours du «patron» de ces médias.
L’Etat devrait trouver les moyens législatifs pour éviter une telle concentration. Mais cette rencontre entre le monde industriel et la presse n’est pas sans dégâts. On se souvient des conflits Kamel Belkacem-Soufi ( le Nouvel Hebdo), Fattani-Rabrab ( Liberté), Aboud Hichem-Betchine ( El Acil) et bien d’autres affaires qui ont défrayé la chronique. Il est même patent de retrouver des conflits d’intérêts entre la presse gouvernementale et les médias privés marqués par les tiraillements et les déchirements. D’ailleurs, les attaques répétées de certains titres contre l’Anep (surtout quand ils n’ont pas signé de convention avec cette régie) semblent absurdes et obéissent à une logique d’intérêts. La question qui se pose, certes, avec acuité, c’est cette propension illogique et non économique de nombreuses entreprises publiques de publier leurs pubs dans les journaux gouvernementaux tirant à quelques milliers d’exemplaires. De nombreux titres publics et privés ne donnent pas leurs tirages réels, ce qui fausse le débat, surtout en l’absence d’un office de justification de la diffusion. Seul, pour le moment, El Watanl’a fait. Les jeux de la manipulation ne sont pas absents. Même les ambassades s’intéressent de plus en plus à la presse, multipliant invitations et visites dans des rédactions trop investies par le travail au noir et les abusives généralisations, espaces de négation de l’écriture journalistique.
Dernièrement, Orascom avait invité des journalistes à une visite au Caire, comme Aigle Azur qui multiplie les contacts et la réduction des tarifs pour les journalistes. Ce qui pose sérieusement problème au niveau de l’éthique qui se porte mal à tel point qu’un journaliste d’un quotidien national défendait publiquement la justesse de pratiques «immorales» dans la presse. En principe, un journaliste ne devrait accepter aucune prise en charge. Il devrait bénéficier de frais de mission conséquents qui le libéreraient de l’enfermement dans les bras de celui qui l’héberge. Il y a même des journalistes qui sont payés rubis sur l’ongle par des entreprises sur lesquels ils pondent des articles alors qu’ils exercent comme permanents dans des organes de presse privés ou publics. Des communiqués de sociétés sont parfois publiés dans certains organes comme s’il s’agit de simples informations. La reprise des dépêches d’agence, parfois non traitées, engendre de sérieux malentendus culturels et politiques.
La diffamation a pignon sur colonnes dans des quotidiens, marquées par l’invective et les affirmations péremptoires prisonnières parfois de pratiques singulières (mode impératif, multiplication de qualificatifs, du passé simple, des phrases longues et des paragraphes interminables, présence de reportages et de personnages imaginaires avec en sus des «observateurs» et des «sources autorisées» à la pelle, sentences religieuses et morales). Mais l’élément le plus important, c’est l’absence d’investissement des directions des journaux dans la formation de leurs journalistes souvent abandonnés à eux-mêmes et d’un syndicat représentatif des professionnels (permanents et collaborateurs). Peut-être demain, les nouveaux besoins des lecteurs imposeront l’émergence d’un journalisme sérieux, professionnel. En dehors de ce regard trop conformiste, souvent militant, «traditionnel» d’une presse qui se compose encore de journalistes trop piégés par les jeux des appareils, de l’institutionnel et du discours tranché, réglé, évitant tout questionnement, exhibant facilement les positions politiques et idéologiques.
Quand des journaux «dénoncent » ce qu’ils appellent le «pouvoir » (souvent non défini, mythique) alors que dans le rituel de leur fonctionnement ou dans la célébration de leurs anniversaires, ils prennent comme lieux-références les espaces «partisans » et les «universitaires» de l’étranger comme si la société algérienne ne les intéressait pas. Dans un compte rendu sur le 20e anniversaire d’ El-Khabar, c’est Ahmed Ouyahia qui constitue la parole centrale d’un texte où il est question de gouvernants qui freineraient la presse. Trop contradictoire. La fascination du «pouvoir » est très prégnante dans le non-dit d’une presse encore trop piégée par les jeux du conformisme et d’une absence d’une logique éditoriale cohérente et cultivée. Heureusement, le web journalisme est déjà à nos portes… Mais il faut reconnaître que, malgré toutes ces insuffisances, les journaux privés ont permis une relative ouverture du champ médiatique. A.C