|
|
Défense (et Sécurité nationale)
Journ�e du Dimanche 10/06/2024 |
|

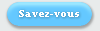
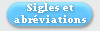
|
-Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé,ce lundi à Alger, l'ouverture des travaux d'un colloque sur "l'industrie du contenu numérique, le garant de la mémoire nationale", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué......................................
-2023 enregistre le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946, selon une étude de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo, publiée lundi 10 juin. Une hausse spectaculaire, accompagnée d’une complexification des formes de conflits et d’une violence accrue.
Le nombre de conflits armés dans le monde augmente, et les affrontements se complexifient, pointe le rapport.
Le bruit des bottes, et le bruit des bombes : guerre civile en Éthiopie, invasion de l’Ukraine, génocide à Gaza… « La violence dans le monde n’a jamais été aussi élevée depuis la fin de la Guerre froide », souligne Siri Aas Rustad, professeur de recherche à l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (Prio) et rédactrice d’un rapport d’analyse des tendances mondiales 1946-2023.
Près de la moitié (28), de ces 59 conflits a eu lieu sur le continent africain. Le nombre de conflits étatiques sur ce territoire a « presque doublé » en dix ans, faisant plus de 330 000 décès au cours de ces trois dernières décennies. Viennent ensuite l’Asie, avec 17 conflits armés, le Moyen-Orient (10), l’Europe (3) et les Amérique (1), où le nombre de conflits non étatiques est le plus élevé. Le Mexique reste l’un des pays les plus violents au monde, selon les chiffres du Programme de données sur les conflits de l’Université d’Uppsala, étudiés par le Prio.Selon l’Institut de recherche norvégien, la hausse du nombre de conflits est due en partie à l’État islamique et sa propagation en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Et aussi à « l’implication d’un nombre croissant d’acteurs non étatiques, tels que les jihadistes de Jama’at Nusrat al-Islam Wal-Muslimin (JNIM) », décrit le Prio.
|
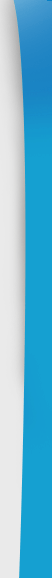 |
|